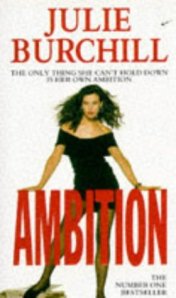Après Thérèse philosophe, Margot la ravaudeuse et Fanny Hill, voici encore un récit à la première personne. Je le trouve cependant différent, dans la mesure où l’héroïne a connu une existence beaucoup moins troublée et ne s’est jamais départie des principes qu’elle a adoptés dès son initiation à la sensualité.
Après Thérèse philosophe, Margot la ravaudeuse et Fanny Hill, voici encore un récit à la première personne. Je le trouve cependant différent, dans la mesure où l’héroïne a connu une existence beaucoup moins troublée et ne s’est jamais départie des principes qu’elle a adoptés dès son initiation à la sensualité.
Félicia, en effet, après une enfance passée dans un orphelinat, a été adoptée par un couple aisé et a, à partir de ce moment-là, mené une vie heureuse et facile. Bien que ses parents adoptifs, Sylvino et Sylvina, soient très amoureux, Sylvino est volage.
Le parfait amour est une chimère. Il n’y a de réel que l’amitié, qui est de tous les temps, et le désir, qui est du moment. L’amour est l’un et l’autre réunis dans un coeur pour le même objet, mais ils ne veulent jamais être liés. Le désir est ordinairement inconstant et s’éteint quand il ne change pas d’objet. […] Défends-toi des sentiments violents ; ils rendent à coup sûr malheureux. Vis mollement dans un cercle de plaisirs tranquilles, que feront naître un luxe modéré, les arts, et des goûts réciproques que tu auras la liberté de satisfaire. […] Fais de bons choix, ne t’engage jamais au point d’avoir plus de peines qque de plaisirs. Préviens le dégoût ; et, puisqu’en galanterie, pour n’être pas malheureuse ou ennuyée, il faut se laisser tromper ou tromper les autres, ménage-toi des illusions flatteuses ; n’approfondis jamais rien de propre à te causer des mortifications et sauve adroitement les apparences, aux yeux de ceux dont l’éclat de tes changements pourrait occasionner le malheur.
Tels sont les conseils qu’il laisse à Félicia, avant de partir pour un long voyage à l’étranger. Très vite, aussi bien Félicia que Sylvina mettent en pratique la philosophie de Sylvino.
Félicia plaît aux hommes : elle se décrit à plusieurs reprises comme pourvue de toutes les grâces physiques et morales (et même de la modestie!) et de talents artistiques, notamment en chant. Je me serais crue dans un récit pornographique d’aujourd’hui, à ceci près que Nercia s’amuse visiblement. Bref, elle n’a que l’embarras du choix pour occuper ses nuits solitaires. Mais elle m’a semblé agir de façon plus raisonnée que Margot ou Fanny Hill : le désir, chez elle, semble moins instinctif que conditionné par la personnalité et le mérite de celui qu en est l’objet.
Le mode de vie adopté par Félicia est très moderne. Bien que Sylvina et elle prennent garde à ne fréquenter que la meilleure compagnie et à bien se différencier des demi-mondaines, elles se qualifient de femmes de plaisir et Félicia trouve normal qu’elles ne soient pas reçues partout, du fait de leurs moeurs. Elles passeraient en revanche sans doute inaperçues aujourd’hui et on prêterait sans doute plus attention à la bonté et à l’intégrité de Félicia qu’à la légèreté de ses moeurs.
Le choix de vie de Félicia reflète les idées d’André-Robert Andréa de Nerciat. Raymond Trousson écrit de lui :
Chez lui, l’érotisme procède d’une philosophie de vie, selon laquelle la satisfaction sexuelle est l’un des éléments essentiels du bonheur et de l’épanouissement de l’individu. Son univers ne connaît aucun prolongement métaphysique et ses personnages songent moins que jamais à l’au-delà ou aux récompenses futures.
Cependant, Félicia, publié anonymement en 1775, est le premier roman de Nerciat et, de loin, le plus chaste parmi ceux-ci, bien qu’il ait été constamment interdit pendant tout le XIXe siècle. En effet, Nerciat, né en 1739, qui a mené principalement une carrière militaire jusqu’à la Révolution, écrit, dans les années 1790, durant lesquelles il passe de l’armée d’émigrés du prince de Condé à la fonction d’espion au service des révolutionnaires, des romans pornographiques dans lesquelles il décrit les pratiques les plus extrêmes sans aucun tabou.
A côté, Félicia fait figure de bluette, bien que certains de ses personnages pratiquent l’inceste à leur insu, et ne semblent pas le moins du monde émus lorsqu’ils le découvrent, ce qui m’a un peu dérangée. J’ai même eu le sentiment que Nercia n’allait pas au bout de son système, car Félicia éprouve à plusieurs reprises des sentiments amoureux, bien que passagers, et connaît ou suscite à d’autres la jalousie. En dépit de la satisfaction qu’elle ressent à propos de sa philosophie de vie, cela me semble démontrer qu’elle ne parvient pas à appliquer parfaitement celle-ci.
J’ai apprécié l’écriture du roman, vive et enlevée, avec des traits humoristiques. Néanmoins, j’ai eu un peu de mal à progresser dedans et je ne l’ai lu que très lentement, à petites touches. Encore une fois, j’ai eu un sentiment de déjà vu à la lecture des premières parties : description des plaisirs de la bonne société, ridicule des dévôts et gens de province, tours joués à ceux-ci qui ne m’ont pas du tout amusée.
Je reconnais toutefois que Nercia a fourni de gros efforts pour apporter de la variété dans son récit afin de ne pas lasser le lecteur : introduction de nouveaux personnages dont les aventures viennent s’enchâsser dans l’histoire principale, introduction d’un personnage triste que rien ne peut dérider dans un roman plutôt joyeux, récits d’aventures et rebondissements. A partir du moment où de nouveaux personnages au passé romanesque et mystérieux font leur apparition dans le roman, j’ai mieux réussi à m’intéresser au récit et j’ai bien accéléré le rythme sur la fin. Pourtant, j’avais vu venir le dénouement assez rapidement et avais l’impression de me trouver dans Les fourberies de Scapin, du fait de la quantité de coincidences tout aussi improbable que dans la pièce de Molière. Je reste donc malheureusement sur une impression assez tiède.
J’ai eu le plaisir, cette fois encore, de faire cette relecture en compagnie de Mina, qui a eu la patience et la gentillesse de m’attendre!